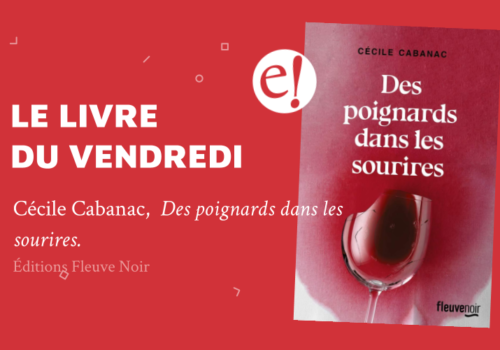S'il manquait quelque chose sur Ernest, c'était bel et bien une place dédiée au roman noir. Si nous avons toujours traité de ces romans noirs qui disent les profondeurs et les failles de nos sociétés et de notre monde moderne, il n'y avait pas d'espace réservé. Cela est désormais réparé. "Regards noirs", c'est le nom de cette nouvelle chronique qui sera animée par Philippe Lemaire, journaliste au Parisien, passionné de romans noirs depuis des années et lecteur acéré. Dans ce premier numéro de son regard noir, Philippe Lemaire nous emmène en Chine, sur les traces de Qiu Xiaolong, auteur renommé qui utilise le roman noir pour débusquer les affres de la Chine rouge. Puissant. D.M.
Vingt ans que Qiu Xiaolong promène son inspecteur Chen dans la Chine d’aujourd’hui. Un flic poète, sensible et désabusé, témoin impuissant des aspirations de ses concitoyens, cadre placardisé d’une police aux ordres du Parti. Vingt ans, et toujours la même fraîcheur, la même acuité chez ce septuagénaire aux yeux rieurs qui incarne l’une des grandes forces du roman  policier : distraire en mettant à nu les turpitudes humaines.
policier : distraire en mettant à nu les turpitudes humaines.
Depuis « Mort d’une héroïne rouge » en 2001, son propos politique moqueur, voire grinçant, se plie avec naturel aux exigences d’une littérature d’évasion. Il affiche la couleur dès le pitch de « Un dîner chez Min », son tout dernier roman. Dans le Shanghai d’aujourd’hui, une courtisane moderne est assassinée : la belle Min vendait à quelques privilégiés ses talents culinaires et parfois aussi son corps. Sexe, élite et repas fins, un cocktail qui sape allègrement les professions de vertu des maîtres de Pékin. Telle est l’ambition qui guide Qiu Xiaolong (prononcer Tchou Chaolongue) : démasquer la Chine rouge qui a brisé sa famille, cette tyrannie qu’il a fuie en 1988 pour le Missouri, avec sa culture et ses souvenirs pour bagages. Avant chaque nouveau livre, son passeport américain en poche, il avait pris l’habitude de retourner là-bas pour de discrètes recherches. « J’ai pu me rendre à Shanghai et dans d’autres villes, nous répond-il par e-mail depuis Saint-Louis, mais je devais présenter mon identité et m’enregistrer partout où j’allais, que ce soit pour prendre un billet de train ou entrer dans un Cybercafé. Et de temps en temps, le flic du quartier venait frapper à ma porte, sans forcément de prétexte ».
Vous avez lu 25% de cet article...
Pour découvrir la suite, c'est très simple :